J'emprunte ce texte. J'espère que je respecte tous les
droits. L'auteur est Gilles Clément, professeur invité sur la chaire annuelle
de Création artistique pour l'année académique 2011-2012 au Collége de France.
Hymne au jardinier, à l'écologie, nouvelle relation avec le vivant...
Source : Cléo/OpenEdition, Unité
mixte de services 3287, CNRS, EHESS, Université de Provence, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 3, place Victor Hugo, Case n°
86, 13331 Marseille Cedex 3, France
Juste quelques phrases pour vous mettre en appétit, tirées de ce
texte :
"Le paysagiste règle
l’esthétique changeante du jardin (ou du paysage) ; le jardinier
interprète au quotidien les inventions de la vie, c’est un
magicien".
"Au jardin, il
suffit d’être et cela demande un silence. Le
silence dont je parle ne concerne pas l’espace de l’enclos – par nature
soumis au discret vacarme des animaux – mais celui qu’il faut aller puiser
au dedans de soi-même en se débarrassant un à un des encombrants savoirs, comme
on le fait de vêtements inutiles. La présence au jardin suppose l’esprit nu et le corps exposé. Il
est alors possible de risquer le rêve".
"Le jardin autorise le désarmement ;
quiconque pénètre le jardin bardé de certitudes se trompe de porte, car même si
le jardin est « botanique », hérissé d’étiquettes savantes, ce n’est
pas la science qu’il nous demande d’apprécier avec dévotion, mais l’incroyable
projet de nous livrer les clefs du vivant grâce à l’approche scientifique,
immédiatement conjurée par l’éclat des pétales de fleurs, le vol d’un bourdon,
le pèlerinage des fourmis, le cri pleuré du pic noir et tout à coup cette
lumière sur l’herbe rousse de l’été qui rejette dans l’ombre un sous-bois
inconnu, donc nouveau".
Ce texte ne se lit pas à la manière du zappeur,
du boulimique d'Internet qui veut tout voir sans rien entendre ni écouter. Il
porte sur les fondamentaux de notre planète et invite au changement de
paradigme.
Bonne lecture
Bernard
BILLET INVITE
Jardins, paysage et génie naturel
Leçon inaugurale prononcée
le jeudi 1er décembre 2011 au collège de France, Gilles Clément.
Parler du jardin ou du paysage dans le cadre du Collège de
France, c’est envisager le jardin et le paysage comme un ensemble susceptible
d’être enseigné sous la forme de cours. De mon point de vue, le jardin ne
s’enseigne pas, il est l’enseignant. Je tiens ce que je sais du temps passé à
la pratique et à l’observation du jardin. J’y ajoute les voyages, c’est-à-dire
la mise en comparaison des lieux que l’homme habite et dans lesquels il
construit à chaque fois un rapport au monde, une cosmologie, un jardin. J’y
ajoute encore les rencontres, la diversité des pensées, la surprise,
l’ébranlement des certitudes. Ces pratiques de terrain auxquelles je dois tout
s’appuient néanmoins sur un alphabet du savoir, ce à quoi chacun de nous
devrait avoir accès et que, précisément, on appelle des cours, nécessaires pour
accéder à l’expérience.
Aussi me suis-je demandé comment on pouvait dispenser un
savoir presque tout entier issu de la confrontation avec le terrain sous une autre
forme que celle de l’atelier. L’atelier : un assemblage d’énergies
croisées où les enseignants, « enseignés » par les étudiants et par
le terrain lui-même, se contentent de réajuster les trajectoires de la
puissance créative pour renforcer la cohérence et la clarté de la pensée. Aussi
je remercie le Collège de France, et plus particulièrement Philippe Descola, de
m’avoir invité à un exercice nouveau : faire passer le champ de nos
hésitations à ceux qui, venus en étudiants, pourraient, à la fin, se découvrir
jardiniers.3
4
Je parle de jardiniers et non de paysagistes, ou de
techniciens de l’environnement, bien que les fonctions correspondant à ces
profils soient liées entre elles. En composant le jardin, le jardinier crée un
paysage ; en l’accompagnant dans le temps, il fait appel aux techniques de
maintenance horticoles et environnementales. Il couvre le champ de la
complexité des fonctions assumées séparément par le paysagiste et le
technicien, mais avant tout il s’occupe du vivant. Cette charge singulière le démarque de tous les
acteurs de l’espace public : les architectes, les urbanistes, les
artistes, les aménageurs divers et, bien sûr, les paysagistes. S’il n’est pas
nécessaire de faire appel au vivant pour construire un paysage, il est impensable
de s’en passer dans un jardin. Pour cette raison, j’utiliserai plus souvent le
terme de jardinier que
celui de paysagiste.
Cela se comprend ainsi : le paysagiste règle l’esthétique changeante du
jardin (ou du paysage) ; le jardinier interprète au quotidien les inventions de la vie, c’est un
magicien.
L’un et l’autre se complètent, mais pour des raisons
historiques récentes qui bouleversent le rapport de l’humanité à son habitat,
on ne peut concevoir le rôle du paysagiste cantonné à la seule construction
formelle ou fonctionnelle de l’espace en faisant abstraction de la dimension
biologique, à moins d’en faire un simple designer, ce qu’il n’est pas.
Jardin, paysage, environnement : trois termes
du langage commun qui demandent précision.
Paysage,
selon moi, désigne ce qui se trouve sous l’étendue de notre regard. Pour les
non-voyants, il s’agit de ce qui se trouve sous l’étendue de tous les autres
sens. À la question : « qu’est-ce que le paysage ? », nous
pouvons répondre : ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé de
regarder ; ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé d’exercer nos
sens au sein d’un espace investi par le corps. Il n’y a pas d’échelle au paysage,
il peut se présenter dans l’immense ou dans le minuscule, il se prête à toutes
les matières – vivantes ou inertes –, à tous les lieux, illimités ou
privés d’horizon : nous pouvons parler de paysage ici-même, au sein du Collège de France, dans
cette salle pourvue de formes, de lumières, de relief et de sol en parterre
tapissé d’humains…
S’agissant d’un ressenti (et de sa transcription, par
exemple dans un tableau : les premiers paysagistes sont des peintres et
non des aménageurs), le paysage apparaît comme essentiellement subjectif. Il est lu à travers un
filtre puissant composé d’un vécu personnel et d’une armure culturelle. La
Beauce, interprétée comme un vide monotone en France, apparaîtra comme une
étendue admirable à un Japonais dont le pays ne bénéficie nullement d’un tel
espace.
Ces constats font du paysage un objet irréductible à une
définition universelle. En théorie, il y a donc autant de paysages, à propos
d’un site, qu’il y a d’individus pour l’interpréter. Il existe, en réalité, des
situations de partage lorsque la beauté dramatique ou sereine d’un paysage
touche de façon égale un groupe assemblé dans le même instant et sous la même
lumière au devant du même spectacle, à la condition que ce groupe partage les
mêmes clefs de lecture, la même culture. Mais nul ne saura quelle émotion
intime anime chaque individu de ce même groupe. Telle est la face
irrémédiablement cachée du paysage.
Environnement est
le juste opposé de paysage en
ce qu’il tente de livrer une lecture
objective de ce qui nous entoure. Il est aussi le versant
partageable du paysage : une lecture scientifique fournie par les
instruments d’analyse que chacun, quelle que soit sa culture, peut entendre et
apprécier de façon comparable. Ainsi mesure-t-on l’acidité ou la basicité d’un
sol (le pH) de la même façon en Europe, en Asie ou en Afrique, avec les mêmes
outils et le même langage de restitution. La valeur sonore d’un site,
l’émission de radiation d’une roche, la charge en oxyde de carbone de
l’atmosphère, le taux de pollution d’un cours d’eau, etc. s’apprécient de façon
comparable et stricte partout sur la planète, ce qui donne lieu à un
« espéranto technique » pour une lecture scientifique du milieu dans
lequel nous vivons.
Le mot environnement,
emprunté à l’anglais sans effort de traduction, désigne un ensemble
difficilement saisissable composé d’une multitude de paramètres fluctuants qui
tous ont à voir avec le vivant.
Les données environnementales d’un site autorisent ou n’autorisent pas
l’expression de la vie, favorisent ou ne favorisent pas l’expression de la
biodiversité.
1. La phusis. « Nature » mais
surtout base de la réflexion philosophique des Grecs d’Asie mineure. La(...)
2. Par les
accords de Nagoya, conclus en octobre 2010 au Japon, plus de
190 pays, à l’exception des Ét (...)
Cet ensemble insaisissable, que d’autres appellent nature, se présente ici sous
l’aspect rude et lisse d’un compte où les facteurs agissants, débarrassés de
toute expression sensible, se traduisent en débits ou en crédits, ce qui
autorise au calcul, au placement, à la spéculation. L’environnement apparaît
ainsi comme la réduction comptable et apparemment maîtrisable d’une complexité
biologique difficile à comprendre et à maîtriser. Alors que la vie ne cesse
d’inventer et d’enchaîner l’imprévisible au prévisible, les données environnementalescalibrées
et estimées permettent ce que les données naturelles1 jamais ne permettaient : la
marchandisation du vivant. Les accords de Nagoya, au sujet desquels les médias
sont restés très discrets, expriment bien cette réalité de l’économie face à la
nature, donc au jardin2.
Terme curieusement choisi pour désigner l’ensemble vivant complexe dans lequel
nous évoluons, environnement se
rapporte aux environs :
ce qui se trouve à distance de nous. La langue espagnole propose medio-ambiante, le « milieu
ambiant », et par-là suggère un état d’immersion plutôt qu’une mise à
distance. Alors qu’environnement nous
désolidarise du « vivant alentour », milieu ambiant nous rend solidaire de celui-ci en
incluant d’emblée le genre humain dans un écosystème planétaire. S’il est
possible de placer les composantes de l’environnement sur le marché, il semble
difficile de procéder de la même façon pour le milieu ambiant, à moins
d’envisager l’humanité elle-même comme une marchandise.
Ces deux termes destinés à nous livrer la nature selon la
lecture la plus scientifique et la plus objective possible aboutissent, on le
voit, à deux attitudes distinctes, à deux regards sur la vie, à deux façons
d’appréhender l’écologie ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Mais on
peut, en passant, vérifier que les mots, censés véhiculer des notions partagées
à l’échelle planétaire, traduisent en réalité différentes façons de voir le
monde. Et de ce point de vue, il est intéressant de poser métaphoriquement la
question : quelle langue voulons-nous parler ? Celle d’une suprématie
sur le vivant ou celle d’une égalité avec lui ?
3 Le
mot jardin vient
du germanique garten qui
signifie « enclos ».Le motparadis,
du latinparadisus(...)
Le jardin échappe aux divisions culturelles. Jardin ne se réfère à l’environnement que pour y
établir les règles heureuses du jardinage, et au paysage pour les seules
raisons qu’il ne cesse d’en créer. Le jardin, partout dans le monde, signifie à
la fois l’enclos et
le paradis3.
L’enclos protège. Au sein de l’enclos se trouve le
« meilleur » : ce que l’on estime être le plus précieux, le plus
beau, le plus utile et le plus équilibrant. L’idée du meilleur change avec les
temps de l’Histoire. L’architecture du jardin traduisant cette idée change en
conséquence. Il s’agit non seulement d’organiser la nature selon une scénographie
de l’apaisement mais encore d’y exprimer une pensée aboutie de l’époque à
laquelle on vit, un rapport au monde, une vision politique. Quelle que soit la
figure stylistique et l’architecture qui en découle au fil du temps, le jardin
apparaît comme le seul et unique territoire de rencontre de l’homme avec la
nature où le rêve est autorisé.
On ne dira pas qu’en dehors de l’enclos se situe le pire
(par opposition au meilleur) mais on y trouve le sauvage inconnu donc
l’inquiétude, la ville à la fois oppressante et commode, le territoire des
rencontres inattendues et des échanges nécessaires, le mélange des devoirs et
des interdits, la panoplie des règles, des obligations et des rapports
domestiques où les triviales questions de survie vident l’espace public de sa
poésie pour le présenter en un lieu d’esquives et d’affrontements. Hors du
jardin, on demande à la société humaine de suspendre un rêve pour défendre une
position sociale, ou simplement pour exister. À l’intérieur du jardin, le
harcèlement existentiel s’évanouit, il n’est plus question de savoir où se
diriger et selon quel ordre de bienséance orienter ses gestes ou son regard, il
n’est pas question de mode d’ajustement à une prétendue modernité ;
inutile d’épater les oiseaux par une quelconque performance dans un esprit
managérial de compétitivité ; au jardin, il suffit d’être et cela demande un
silence.
Le silence dont je parle ne concerne pas l’espace de
l’enclos – par nature soumis au discret vacarme des animaux – mais
celui qu’il faut aller puiser au dedans de soi-même en se débarrassant un à un
des encombrants savoirs, comme on le fait de vêtements inutiles. La présence au
jardin suppose l’esprit nu et
le corps exposé. Il est alors possible de risquer le rêve.
Le jardin autorise le désarmement ; quiconque pénètre
le jardin bardé de certitudes se trompe de porte, car même si le jardin est
« botanique », hérissé d’étiquettes savantes, ce n’est pas la science
qu’il nous demande d’apprécier avec dévotion, mais l’incroyable projet de nous
livrer les clefs du vivant grâce à l’approche scientifique, immédiatement
conjurée par l’éclat des pétales de fleurs, le vol d’un bourdon, le pèlerinage
des fourmis, le cri pleuré du pic noir et tout à coup cette lumière sur l’herbe
rousse de l’été qui rejette dans l’ombre un sous-bois inconnu, donc nouveau.
Où se place exactement le mystère ? Dans cet éclairage
décalé qui transforme un objet familier en une apparition ou dans le pouvoir
inventif de la vie – propre au jardin et à son foisonnement –
obligeant chaque jour le jardinier à changer son angle de vue ? Avant de
comprendre, soyons assuré de notre étonnement. Dans cette phase fragile de la
surprise au jardin – l’esprit nu et le corps exposé – nous mettons à
l’épreuve le regard de l’enfant du temps de sa liberté, avant qu’il n’apprenne
par cœur ou par force la litanie des règles de vie. Dans ce voyage aventureux,
le panneau « Pelouse interdite » nous ferait rire ou nous ferait
douter d’être entré dans un véritable jardin, à moins qu’il ne soit posé là simplement
pour nous étonner.
Nous ne savons pas en quoi précisément consiste le
« meilleur » puisqu’il varie avec le temps. Ce que l’on maintenait
autrefois hors de l’enclos – le sauvage, la mauvaise herbe – pénètre
aujourd’hui le jardin. Il peut même en être le sujet principal. Nous pouvons
nous demander ce qui a si brutalement changé dans l’histoire de l’humanité pour
qu’une valeur décriée devienne un trésor apprécié. Quelle est donc cette herbe
qui nous dicte sa loi ?
4 Le concept
d’écologie, proposé par le biologiste libre-penseur allemand Ernst Haeckel,
apparaît off(...)
Le jardin est une fabrique de paysage, nous l’avons dit, il se
prête aux jeux de l’environnement nous
le savons, mais en contenant le rêve,
il porte un projet de société. Tout au long de son évolution
– architecturale, stylistique – il ne cesse de refléter une vision du
monde en s’approchant le plus possible d’un idéal de vie. Mais au cours des
dernières décennies, le jardin circonscrit à l’espace du jardinier – l’hortus conclusus – change
brusquement de statut, il sort de l’enclos. Un apport sociétal considérable,
dès la première moitié du xxe siècle, modifie non seulement
l’idée du meilleur au sein de l’enclos, mais il bouleverse l’enclos lui-même au
point de le faire disparaître. L’écologie est née4.
En soi l’écologie constitue un avènement.
Destinée à situer les êtres vivants dans leur habitat et à
les comprendre au travers des relations qui les lient les uns aux autres, cette
science est avant tout un choc
culturel, un constat par lequel l’ensemble des êtres vivants se
trouvent enchaînés dans un système complexe incluant l’humanité, l’air, l’eau,
les roches et l’invisible champ des énergies, chaque élément ayant une
incidence sur tous les autres dans un espace fini : la planète.
L’analyse écologique nous amène à situer l’homme en position
d’équivalence biologique avec les autres êtres de nature, c’est-à-dire en
position d’égalité quant à la dépendance face à l’écosystème planétaire, quelle
que soit l’apparente supériorité de l’emprise humaine sur le territoire.
Contrairement à ce que véhiculent les mythes et les croyances, le voici en
situation d’immersion et
non de dominance. Il n’est plus l’être par qui tout se règle et s’organise, il
n’est plus celui vers qui tout converge, le voici en relation directe avec les
composants de l’univers terrestre, vivant au jour le jour les contrecoups de
ses propres actions. Il ne lui est plus possible d’attribuer les grands
changements aux seules forces naturelles et surnaturelles, il doit admettre sa
part active dans les réajustements biologiques de la planète. Depuis la fin
du xixe siècle, nous sommes entrés dans
l’ère anthropocène, écrit Claude Lorius5 : l’humanité
imprime son action à l’échelle du globe avec une puissance comparable aux
puissances géologiques mais à une vitesse bien plus grande. Nous sommes loin
des positions avantageuses où l’humanité perchée sur un piédestal regarde l’environnement avec calcul et
condescendance ; la voici nageant dans le bain commun de la planète, une
eau partagée, bue, transpirée, digérée, évaporée et redistribuée maintes et
maintes fois au cours des temps, toujours la même sous des formes toujours
nouvelles mais en quantité comptée ; tel est le milieu ambiant.
Avec le constat de finitude écologique, les sociétés humaines se trouvent
contraintes de réajuster leur processus de développement, leurs techniques
d’exploitation et leur système de recyclage. De tous les enseignements apportés
par l’écologie, la prise de conscience d’un espace fini et non extensible
constitue sans doute la révolution la plus lourde de conséquences, la plus
difficile à accepter.
On le voit, l’écologie bouleverse en profondeur nos
sociétés. Elle s’en prend sans le dire aux convictions établies et jusqu’alors
peu discutées. D’un côté, elle atteint les croyances et les mythes : la
position de l’homme face à la nature n’est plus conforme aux Écritures
(fig. 1). D’un autre côté, elle contredit le modèle économique du
développement illimité, incompatible avec les propres limites de l’espace
vital : la biosphère (fig. 2).
Figure 1. La troisième vision d’Hildegarde de Bingen :
l’homme au sein de l’Univers (Scivias, xiie siècle).
L’ensemble du cosmos semble se déterminer en rapport avec
l’homme.
Figure 2. La planète Terre vue depuis la
station Mir.
Une perception éloignée de
la biosphère, espace vital limité à une fine pellicule représentée
ici par la couche nuageuse.
Photographie : Jean-Pierre Haigneré.
Ces
deux atteintes aux certitudes, ancrées dans nos esprits depuis des décennies ou
des siècles, suffisent à faire de l’écologie une science mal aimée, mal
entendue, mal transmise car culpabilisante avant d’être éclairante. Mais elle a
valeur de paradigme car
elle modifie notre regard sur le monde et, partant, notre conception de la vie.
En ce début de xxie siècle, on ne fait qu’appréhender
avec réticence le véritable projet du futur en intégrant l’écologie par petits
bouts, çà et là distribués en séries de mesures cautérisantes, alors que cette
pensée révolutionnaire, je pèse mes mots, suffit à elle seule à construire un
projet politique à part entière. Comment s’y prendre ?
Que fait le jardinier ?
De tout temps, le jardinier n’a cessé d’exercer les trois
fonctions de son travail d’excellence :
·
l’organisation de l’espace,
·
la production,
·
l’entretien dans le temps.
Jusqu’au début du xxie siècle,
le jardinier était l’architecte du jardin, le pourvoyeur de fleurs, de fruits,
de légumes, celui qui taille, tond, ratisse, arrose et nourrit… Subitement le
voici responsable du vivant,
garant d’une diversité dont l’humanité entière dépend. À ce rôle nul n’est
préparé. Le jardin d’aujourd’hui, a
fortiori celui de demain, se doit d’intégrer cette pratique
exploratrice – protéger la vie – faute de quoi il met le jardinier en
danger.
Mais qui est le jardinier de ce jardin-là ?
C’est ici que s’opère le grand basculement, ce par quoi les
passagers de la Terre, en accord ou non avec les théories du changement
annoncé, cessent d’occuper le territoire, par une simple oblitération ou une
brutale exploitation de celui-ci, pour en devenir les jardiniers.
Puisqu’il s’agit de la vie, le jardinier de ce jardin-là se
transforme en un peuple. Qu’on le veuille ou non, le jardin renvoie à la
planète. Si, dans sa configuration initiale, il n’a jamais cessé d’accueillir
les espèces venues du monde entier – et par là de constituer un index planétaire – le voici
désormais écologiquement lié à l’espace voisin, lequel se trouve à son tour lié
à un autre, plus lointain et ainsi de suite, jusqu’à faire le tour de la Terre.
Le jardin d’aujourd’hui ne saurait s’en tenir à l’enclos traditionnel, il
oblige le voisinage au partage. Les insectes, les oiseaux, l’oxygène et l’eau
n’ont pour autre contenant que la surface de la Terre et l’épaisseur de la
biosphère, ils franchissent les barrières institutionnelles. Toute clôture à
l’intérieur du jardin planétaire relève de l’illusion et s’apparente à une
archaïque vision de la maîtrise du vivant.
Cependant, les limites du jardin planétaire existent bien
réellement, elles se situent aux limites mêmes de la biosphère, du sommet de la
troposphère aux premières épaisseurs de la lithosphère. La planète ainsi perçue
répond bien aux définitions du jardin : nous voici dans un enclos commun. S’agit-il pour
autant d’un paradis ?
À l’intérieur de ces limites, dans le cœur animé de la
biosphère, là où se développent les micro-organismes, où s’agitent les animaux
et les humains, il n’est question que de partage. Seulement cela. À titre d’exemple, nous
partageons l’air chargé de l’oxygène produit par les océans et les forêts. Tout
est partage. Partage obligatoire pour les raisons évidentes de finitude ; il s’accompagne
d’un recyclage de toutes choses, lui aussi rendu obligatoire, au sein d’un
système considéré comme unique et clos.
C’est pourquoi les processus de captation du bien commun
organisés par les puissantes entreprises multinationales – le décompte et
la marchandisation du vivant par exemple – agissent à l’encontre de
l’équité dans la mécanique du partage de ce bien commun qu’est la nature. La
totalité du modèle économique sur lequel reposent nos sociétés s’oppose
frontalement au jardin planétaire, non seulement en déréglant les équilibres du
partage équitable des biens communs, mais aussi en altérant les capacités
biologiques du jardin lui-même, menaçant ainsi la vie sur Terre. Dans ce
jardin-là, le jardinier a besoin d’urgence d’un assistant talentueux et rêveur :
un nouvel économiste.
·
6 « Économiser signifie prendre
soin » (Bernard Stiegler, Ce qui vaut la peine d’être vécu. De la
pha (...)
Celui-ci n’envisage pas la mise en œuvre et l’évolution du
jardin en se pliant aux lois du marché, qui exigent une toujours plus grande
consommation de tout dans un univers prétendu ultralibéral car dérégulé, plié à
la dictature de la spéculation. Il porte son attention sur ce qui installe et
valorise le vivant sans assistance, en s’inspirant des capacités naturelles de
celui-ci à s’autogérer. Autrement dit, il « économise », il fait son
métier6 ! Il constate qu’un excès d’eau ou
de nourriture conduit à la mort des espèces qu’il prétend protéger. Il apprécie
l’arbre abandonnant son feuillage à l’arrivée des froids ou à la fin d’une trop
grande sécheresse, ménageant ainsi ses dépenses d’énergie au point de
s’endormir. Il s’étonne du long sommeil des semences, capables de vivre sans en
avoir l’air durant des mois, des années, des siècles en l’attente des
circonstances favorables pour germer et entamer le cycle des échanges d’énergie
qui feront exister la plante. Il s’intéresse à l’ajustement des êtres à leur
milieu et vérifie que toutes les espèces ne s’accommodent pas du même sol ou du
même climat, mais il constate qu’en chaque lieu, quelle que soit la pauvreté
des sols, des plantes et des animaux s’installent. Ce faisant, il établit deux
grands principes économiques que les sociétés humaines semblent avoir
oubliés :
·
le non-endettement,
·
la localisation des échanges.
Le non-endettement consiste à gérer les flux entrants et
sortants – eau, sels minéraux, énergie solaire – de façon à ce qu’ils
s’équilibrent sans créer de déficit, augmentant ou diminuant en fonction des
offres et des nécessités, sans plus.
La localisation des échanges semble caractériser le monde
végétal assigné à demeure tandis que le monde animal, en mouvement, pourrait
s’en affranchir. En réalité, les plantes comme les animaux (migrateurs ou non)
élisent un site à leur convenance en instaurant le meilleur système d’échange
pour la moindre dépense possible. Tel est le biotope, milieu choisi par l’être en quête de conditions
naturelles compatibles avec ses exigences de vie.
En s’avisant du « faire avec » dans le biotope
concerné, l’assistant du jardinier, l’économiste rêveur – engage un projet
de société où le jardin, forcément soumis à la vision planétaire, se déploie en
réalité par une série d’échanges localisés dans un souci de la non-dépense.
Comme on le voit, le principe bien diffusé dans la sphère altermondialiste
d’une « vision globale / action locale », s’il ne s’inspire pas
directement des fonctionnements de la nature, trouve dans celle-ci un modèle
direct et complexe. Par les multiples biotopes et les multiples espèces encore
en présence sur la planète (la biodiversité), il trouve là un modèle infiniment
déclinable dont chaque résolution par ailleurs non transposable, correspond à
un lieu, à un milieu et à un ensemble vivant particuliers.
Dans ces conditions, et seulement dans celles-ci, s’instaure
le jardin représentatif de l’idée du « meilleur » en ce début de
siècle : faire le plus
possible « avec », le moins possible « contre » les
énergies en place en un lieu déterminé.
Deux questions alors se posent :
·
Ainsi localisé dans un rapport d’échanges
inféodés au biotope, le jardin prétendu libéré de son enclos d’origine
viendrait-il à s’enclore à nouveau, instaurant ainsi des barrières d’échanges
matériels ou des barrières idéologiques ?
·
Un tel jardin pourrait-il s’accommoder des
formes connues et répertoriées par l’Histoire ? Quelle architecture,
quelle esthétique, quel art pour l’idée du meilleur aujourd’hui ?
La première question pointe sur la réalité et la nécessité
des échanges distants. Le biotope, en tant que milieu défini, ne se présente
jamais comme un territoire aux frontières infranchissables. Les oiseaux le
savent bien, les mammifères et les insectes aussi. Les plantes vagabondes
également, n’hésitant pas à expérimenter un nouvel habitat dès lors que les
conditions d’accueil à leur tempérament pionnier leur sont favorables : un
petit labour, un accident de sol, un soulèvement de taupinière et voilà le sol
nu prêt à recevoir les espèces venues d’ailleurs.
Certaines de ces espèces vont se plaire et s’installer
durablement. Quelques-unes vont se développer exagérément et inquiéter le
jardinier. Dans certains cas, elles seront montrées du doigt, décrétées
indésirables, invasives, pestes végétales à éradiquer absolument. Dans la
majorité des cas, elles seront tolérées, voire appréciées comme tout exotisme
ou toute nouveauté capable de susciter la curiosité, l’étonnement.
Quoi qu’il en soit, la composition floristique et
faunistique du biotope – on pourrait dire du jardin – évolue avec le
temps. Elle donne naissance à ce que la science d’aujourd’hui, dans un élan de
compréhension à l’égard de tout ce qui advient sans prévenir, appelle un écosystème émergent.
Un écosystème émergent n’est autre qu’un territoire de
réajustement des énergies exogènes aux énergies endogènes, un lieu permanent dubrassage planétaire agissant
comme une des mécaniques principales de l’évolution sur Terre (fig. 3).
Une espèce venue de loin, viable dans un biotope élu
deviendra, avec le temps et avec ce que l’on appelle mystérieusement une réponse du milieu, une espèce
écologiquement assimilée à ce milieu.
Le schéma des échanges
proches et lointains montrés sur ce dessin correspond à une interprétation des
échanges économiques souhaitables pour une société nouvelle. Il fait partie
d’une série de dessins exposés à la Biennale d’art contemporain de Melle en
2009 sur le thème de « l’homme symbiotique ». Ce même schéma est
applicable aux échanges d’énergie entre les biotopes naturels. Chaque biotope
est destiné à évoluer sous la pression des influences naturelles externes comme
chaque société humaine sous la pression des influences culturelles externes.
Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Si chaque biotope occupant la surface du globe se voit
soumis à un tel mécanisme, on comprend que la planète, en tant que jardin
constitué de l’addition de tous ces biotopes, se voit soumise à un perpétuel
réajustement.
Dans ces conditions, le jardinier (ou le paysagiste) ne
saurait s’en tenir au projet dessiné du jardin (ou du paysage) et à sa mise en
place en estimant celui-ci immuable. Maintenir dans le temps l’image initiale
relève de l’illusion et ne semble destiné qu’à assurer le maître d’œuvre d’une
soi-disant maîtrise de l’œuvre. Il faut ici se dégager radicalement du contrat
absurde par lequel le paysagiste (ou le jardinier) se trouverait garant d’un
paysage définitif, contrat abusivement copié sur celui des architectes et,
malheureusement, toujours en vigueur. À la réception du chantier, l’architecte
peut estimer que la maison est finie ; à la réception du chantier, le
paysagiste sait que le jardin commence.
Il ne finit pas. Il n’est jamais fini mais il évolue comme
tout système vivant au sein de l’espace fini. Le jardin est dans le jardinier. Il existe par
le jardinage. Que
devient sa forme dans le temps ?
C’est ici la deuxième question. En quoi l’écologie,
subitement intégrée aux dimensions historiques du jardin, vient-elle perturber
l’aspect formel, le réglage esthétique, l’excellence artistique ?
Le jardin écologique peut-il répondre aux exigences d’un
enseignement dans le cadre d’une chaire de Création artistique au Collège de
France si cette même création, constamment mise à mal, souffre de la confusion
des formes sans cesse renouvelées ?
Qu’est-ce que l’évolution de la forme soumise aux dynamiques
biologiques dans l’espace fini ?
Jusqu’au début du xxe siècle,
avant l’avènement de l’écologie, on pouvait envisager l’évolution formelle de
l’espace comme un développement spatial, une extension, un accroissement ainsi
qu’on peut le voir à propos des villes. Accroissement tridimensionnel, gagnant
les surfaces du territoire et les volumes de l’atmosphère, accroissement des
activités et des modes de communication sous la pression de l’accroissement
démographique (fig. 4).
À partir du milieu du xxe siècle,
et bien que cela répugne aux désirs expansifs de l’humanité et aux règles
irresponsables de son économie dominante, il n’est plus possible d’envisager
l’évolution formelle de l’espace comme un simple déploiement, une simple
prolifération des inventions de l’esprit, devenues les objets et les matières
oblitérant durablement la peau de la Terre. En épuisant les surfaces du corps,
le tatouage vient à bout de sa propre expression. Il ne reste plus qu’à effacer
pour tout recommencer. Est-ce possible (fig. 5) ?
Figure 4. L’évolution des sociétés envisagée comme une
expansion progressive des habitats au détriment de l’espace libre.
Figure 5. L’évolution des sociétés envisagée comme une
réécriture des principes de vie au sein d’un même espace (recyclage).
Pour les sociétés soumises aux logiques du visible, la forme
apparaît en pleine lecture sous l’aspect simplifié de la géométrie, l’espace mesurable.
L’architecture – des bâtiments ou des jardins – exploite abondamment
les vertus de la géométrie jusqu’à dresser une ordonnance du jeu des
formes : accélération ou ralentissement des perspectives, nombre d’or,
règles de construction. L’art, à ces conditions, revient au talent de
l’agencement et se contente du réglage esthétique des matières et des lumières
capables de les animer dans la géométrie voulue.
·
7 Henri
Laborit, La Nouvelle Grille, Gallimard, coll. « Folio
essais », 1985.
Le jardin, à cause de la préséance donnée au vivant,
bouleverse ces lois. Pour un biologiste, nous dit Henri Laborit7, la forme n’est qu’une
étape transitoire sur le chemin de l’évolution, c’est un signal, une information. Il s’agit
d’abord d’un message. Tout message, formellement codé, reçu par un organisme
vivant, est aussitôt interprété, complexifié et renvoyé dans l’environnement.
La forme cesse d’être une fin en soi pour devenir un moyen de communication au
service de la vie.
Nous, jardiniers, pouvons-nous abandonner la composition
formelle de l’espace, si lisible, si spectaculaire, au profit d’un échange de
messages dont, au demeurant, nous ne comprenons pas grand-chose ? Ceci, au
nom de la vie ? Comment intervenir dans l’obscure et invisible
communication physico-chimique des espèces qui nous entourent ? Que
signifie précisément effacer
pour tout recommencer dans un modèle de société où l’effacement
demanderait autant d’énergie, sinon plus, que la création d’origine ?
Les avancées de la science nous amènent à considérer
l’ensemble des espèces présentes sur Terre – la biodiversité – comme
un appareil d’une étonnante complexité dont chaque élément se trouve en
permanence connecté avec tous les autres. L’Internet biologique fonctionne
depuis la nuit des temps. Où se trouve notre place dans cette gigantesque
discussion ?
Si, au nom de la sauvegarde de la diversité, c’est-à-dire de
la vie sur Terre, l’information biologique doit prendre le pas sur la forme en
tant que préséance dans le projet de paysage ou celui de jardin, alors
l’artiste doit changer d’outils pour faire émerger son œuvre et, avant cela, il
doit changer de regard.
Considérer l’épaisseur du vivant, au sein d’une friche,
comme un système ordonné où chaque être et chaque comportement répondent à une
logique biologique pour s’inviter au débat – ne serait-ce que pour y faire
sa place –, c’est renoncer à la violence de la mise en forme
architecturale pour initier un dialogue où le jardinier, avant d’intervenir, fait
appel au génie naturel.
Par génie
naturel, il faut entendre le pouvoir des espèces animales et
végétales à régler naturellement leurs rapports en vue de se développer au
mieux dans la dynamique quotidienne de l’évolution. La nature, dans sa
complexité, a mis au point un nombre considérable de signaux, d’avertissements,
de déclencheurs de réactions en chaîne, de régulateurs de surpopulations,
d’assistances et de prédations qui « jardinent » le territoire sans
aucune intervention humaine. Cette débauche d’énergie s’opère en réalité dans
une économie d’échange, au rythme d’une musique naturelle que chacun peut
entendre : le cri d’un oiseau, la stridulation d’un orthoptère, le vent
dans un feuillage portant l’information masquée d’un prédateur ou d’un ami, la
distance entre les frondaisons laissant voir le ciel (fig. 6). Tout est
message.
La lumière résulte d’une mise à distance des frondaisons
d’arbres adultes appartenant à la même espèce (ici, Samanea saman en Australie, au
nord de Cairns).Cette mise à distance correspond à des échanges entre les
houppiers. On ignore la nature et les raisons de ces échanges.
Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Tant d’énergie gratuite : le jardinier n’a qu’à se
mettre à l’écoute pour en tirer parti, comprendre avant d’agir et ainsi limiter
son intervention. Faire le plus
possible avec, le moins possible contre.
Ainsi l’artiste du jardin à venir devra-t-il accepter la
formidable collaboration de la nature comme co-signataire de son œuvre. Il ne saurait être l’auteur
du tout, mais seulement d’un fragment de l’espace et, pour faire durer son
œuvre, il doit s’accommoder du temps en infléchissant les directions prises par
la nature sans pour autant les contredire.
Si l’on tentait de faire figurer la part d’intervention de
l’artiste dans cette aventure du jardin, il faudrait la réduire à un trait,
peut-être même à un point placé dans l’ensemble profus et vaste du territoire
laissé à la nature (fig. 7 et 8).
La part de l’intervention de l’artiste (traits et points
soutenus) permettant une scénographie particulière de l’espace envisagé ne
signifie pas un abandon de ses prérogatives sur le milieu vivant (petits
points) mais une limitation de son action formelle à ce qui rend lisible son
message.
Copyleft
Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Jardin de l’École normale supérieure de Lyon, site Descartes
(Lettres et sciences humaines).
Copyleft
Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Le jardin résulte toujours d’une action combinée de l’homme
avec la nature, mais ici la dépense
d’énergie contraire est portée à sa plus faible
expression : elle doit se placer au juste endroit pour que l’ensemble dû au génie naturel
devienne finalement un jardin.
Ici intervient l’excellence de l’artiste : il exerce
son art au traitement des limites.
L’artiste du paysage heureux, capable d’entretenir et de
développer la vie dans son jardin, ne s’interpose pas dans le rapport naturel
des échanges, il le valorise par une scénographie appropriée. Un socle, une
démarcation, un dénivelé, une limite – fût-elle épaisse comme une lisière
de forêt – dont la forme s’accorde
autant au sens du projet proposé qu’au respect de la vie.
Comment devient-on un artiste des limites ? N’est-ce
pas réduire l’artiste à une tâche mineure que de l’assigner aux seules
interventions de limites ?
Nous entrons ici dans le domaine élargi de l’immatière, le territoire de la
connaissance. Il est en réalité bien plus difficile de traiter la limite avec
justesse, en laissant s’exprimer le génie naturel dans sa meilleure expression,
qu’en intervenant avec violence sur l’ensemble vivant pour ne faire apparaître
que le geste final de l’architecture. Car cela suppose un savoir.
L’intervention ponctuelle et marginale du jardinier des limites s’opère à
partir d’une reconnaissance précise des espèces et des comportements en
jeu : observer, déterminer et comprendre le vivant. Mais en quel lieu
aujourd’hui fait-on ses classes pour observer, déterminer et comprendre le
vivant ? Existe-t-il une école du jardin planétaire, une école du génie
naturel, un système éducatif à disposition de tous où la compréhension du
vivant – à commencer par l’alphabet : savoir nommer (ce qui a un nom
existe, ce qui n’a pas de nom n’existe pas) – prime sur toute autre
discipline ?
·
8 Yves Delange, Plaidoyer
pour les sciences naturelles : dès l’enfance, faire aimer la nature et la v (...)
À de très rares exceptions près, ce système éducatif à la
portée de tous n’existe pas en France. La botanique (l’alphabet de la flore),
progressivement abandonnée, n’est enseignée que ponctuellement et partiellement
dans les établissements spécialisés destinés à la formation agricole, horticole
et paysagiste. Les disciplines fondamentales pour la compréhension des
écosystèmes – l’entomologie, l’ornithologie par exemple – inexistantes
dans l’enseignement officiel, reviennent aux amateurs et aux savants isolés,
comme si la nature, trop compliquée, devait indéfiniment demeurer l’apanage des
hyper-spécialistes ou des poètes8.
·
9 L’une des
exceptions intéressantes, en matière de centres de formation appliquée à la
nature et au(...)
Nous avons changé de règne, nous avons changé d’ère,
l’Anthropocène d’office nous assimile à la nature. Si nous n’acceptons pas
cette assimilation par un effort d’humilité, nous continuerons à nous en croire
distants pour la dominer, c’est-à-dire, finalement, la détruire. Nous sachant
au terme de cette chaîne de dépendance qui nous lie à elle, il ne nous est plus
possible d’agir autrement que dans un rapport de connivence et de partage9.
Nous savons le paysage intimement lié à notre lecture
subjective et culturelle, l’environnement dédié à un décompte objectif des
composantes du vivant, le jardin territoire du rêve, accueil du meilleur et
projet politique.
Nous observons la puissance du constat écologique et la
capacité de celui-ci à reformuler les idées du « meilleur » au sein
de ce qui devient alors le jardin planétaire. Nous vivons sous l’emprise de ce
choc sans avoir pris les mesures de son amortissement et de son intégration à
la vie courante, mais nous en avons la conscience.
Nous assistons à l’effondrement d’un système économique basé
sur l’exploitation fictive d’inépuisables ressources. Dans le même temps, nous
assistons aux expérimentations multiples et localisées des économistes rêveurs
et des jardiniers humanistes engageant les modèles du futur. Nous constatons la
part à la fois infime et décisive de l’artiste sur ces modèles en ce qu’il
modifie le tout par une intervention sur les limites et non sur la totalité du
système.
Nous avons compris que le système, fût-il émergent, issu du
brassage planétaire et en constante évolution, n’est pas réductible à
l’évaluation comptable des agences de notation – gadget à l’usage de peuples
infantiles et des joueurs de poker. Il s’agit d’un ensemble complexe impliquant
la profondeur de l’âme en même temps que les caprices du vent et la
transformation d’une goutte de pluie en un flocon de neige, en un lieu unique
et non renouvelable : la planète.
Pour avancer et construire le projet de demain – le
jardin de demain –, il nous reste au moins deux champs d’investigation
posant des questions auxquelles nous devons en urgence apporter des réponses.
La première concerne l’absolue nécessité du recyclage en territoire
fini. Le constat de finitude écologique s’oppose en apparence à la poésie du
monde en ce qu’il nous assigne à la matière sans laisser l’esprit dans cet état
de grâce que l’on concède volontiers à l’enfance : l’insouciance.
On nous demande de reconnaître, de trier, d’organiser, de
redistribuer l’ensemble des déchets produits par nos sociétés
consuméristes : l’énergie est transformée, difficilement utilisable et
finalement jetable. Doit-on mettre la poussière sous le tapis, les déchets
nucléaires au fond des fosses marines et fermer les yeux, ou chercher la
solution du bon recyclage ? Comment replacer dans l’environnement (donc
dans le paysage et dans le jardin) l’énergie qu’on lui prend ? Peut-on
opérer ce replacement sans disqualifier le milieu concerné ? Comment
remettre dans la rivière de l’eau non polluée après usage ?
Que serait la ville recyclable ? Comment concevoir des
objets de consommation en vue de leur recyclage obligé ? Qu’est-ce qu’une
architecture recyclable, sinon éphémère et fragile, capable de se décomposer
pour se reconstituer ? Quelles sociétés accepteront de voir disparaître
leurs constructions pour des questions de finitude écologique et
spatiale ? Si les traces disparaissent, la mémoire s’efface en tant que marqueur
de paysage. La voici sélective et ciblée, réduite à la tradition orale, aux
textes, à l’immatière et
à quelques monuments pour lesquels on aura souhaité, sans trop y croire, une
certaine éternité. Dans notre jardin planétaire, sommes-nous prêts à envisager
toute chose comme à la fois éphémère et transformable ? Notre maison
peut-elle devenir une automobile, notre automobile un ordinateur et celui-ci un
jardin ?
Au jardin nous savons que les feuilles en décomposition sont
la nourriture des fraises et des poireaux, la litière temporaire des racines du
chêne. Le recyclage naturel extrêmement précis, mis au point depuis des
millénaires, entretient la vitalité des sols et de l’air, l’expression de la
diversité (fig. 9). Toute intrusion maladroite et pérenne plaçant dans le
jardin un objet inerte menace le recyclage naturel et vise à la stérilisation
de l’espace impacté, à moins de transformer les parois de cet objet en un sol
nouveau.La ville recyclable à la
mémoire ciblée serait alors un compromis d’architecture
éphémère et d’architecture durable transformée en jardin. Puisque nous sommes
dans l’obligation du recyclage, le projet urbain de demain pourrait bien
s’inspirer de cette partition entre le recyclable industriel et le recyclable
naturel. L’un dépense l’énergie que l’autre produit.
Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Il s’agit d’un chantier considérable. Sans doute la plus
vaste entreprise humaine depuis l’histoire de la sédentarisation des peuples
qui tous furent nomades avant d’inscrire au sol leurs premières fondations et,
partant, leur premier jardin. Il n’est plus question désormais de faire durer
la ville, le paysage ou la planète. Il est question de réinventer l’espace de
vie en y recyclant la production d’apparence inutile venue de toutes les
sources de consommations – ce qu’on appelle déchets – pour les
transformer en matériaux de construction et d’usage courant. En choisissant
comme slogan O lixo que no e
lixo (« un déchet qui n’est pas un déchet »), la
ville de Curitiba au Brésil anticipe les urgences du futur et propose un des
modèles possibles de gouvernance urbaine.
Le risque majeur d’une telle évolution est la probable
récupération par le marché, une sorte de « grenellisation »
planétaire obligeant les sociétés à produire toujours plus de déchets pour
reconstruire toujours plus et
spéculer. Mais il existe un court-circuit à cette folie : produire
toujoursmoins de
déchets, tel est le pouvoir du citoyen, celui du boycott et du libre choix qui
passe par le renoncement, non à ce qui nous semble superflu, ce luxe nous est
vital, mais à ce qui nous semble inutile, non ajusté à nous-même. On ne peut
faire boire à une plante plus d’eau qu’elle ne peut en absorber au risque de la
noyer. On le sait, le chantier est immense. Mais, d’une façon secrète et
parallèle, il est engagé. Sans le dire et par force, sous la pression des
effondrements du système, une multitude d’initiatives dispersées mais actives
construit les bases d’un jardin éloigné des économies marchandes. Le voici
vibrant, atomisé, constitué d’identités associées à chaque biotope où les
productions, distributions et recyclages s’opèrent localement.
L’artiste du jardin
atomisé est donc celui qui voyage d’un écosystème à l’autre et qui saura, par
comparaison et grâce au voyage – c’est-à-dire grâce à une vision
globale – proposer la meilleure solution locale.
Mais à quelle vitesse engager le voyage ? Quel délai
pour le recyclage ? Faut-il courir ou s’arrêter ?
Voici le deuxième champ d’investigation des chantiers du
futur : le temps, son usage, sa prise et son abandon.
Pour des raisons liées aux saisons, au rythme des flux dans
l’organisme des plantes, à l’incidence énergétique du soleil, à l’abondance ou
à la rareté de l’eau, les végétaux prennent leur temps. Ils se décident au
développement lorsque les circonstances nécessaires au développement sont
réunies. Accélérer le processus les amènerait à croître dans des conditions
menaçant leur propre vie. Alors ils attendent le moment venu. Le bon moment. Ni
crédit ni dette de temps. À aucun moment le temps ne représente un placement,
un objet de spéculation, il est juste ou
alors il n’est pas.
L’exemple le plus puissant, et pourtant le moins regardé
sous cet angle, est la graine : la semence en sommeil. La graine retient
le temps. Nous ne savons pas jusqu’à quel point, elle non plus. Elle attend le
moment venu. Elle retient et elle efface le temps. Entre l’instant de sa
naissance, à partir du fruit, et l’instant de sa croissance, il ne se passe
rien. Rien pendant des semaines, des mois, des années. Parfois des siècles.
Ce rien efface le temps mais il contient la vie. Sans doute
ne sommes-nous pas suffisamment avisés de l’extrême performance de cette vie en
dormance. Comment résister aux conditions du désert pendant des décennies et
subitement fleurir à l’occasion d’une pluie, comment patienter au fond d’un sol
et attendre un retournement (le travail d’une taupe ?) pour se déployer,
comment s’enkyster au point de supporter le gel, comment réduire sa
respiration, son évaporation, ses échanges avec l’extérieur ? D’une telle
apnée biologique, aucun autre organisme n’est capable. C’est l’exemple le plus
spectaculaire d’une parfaite et totale économie. Et pourtant, une graine, c’est
petit.
À partir des semences, nous sommes assurés de créer des
paysages adaptés car elles savent ce que nous ne savons pas : le choix du
bon moment, celui du juste temps. À partir des semences, les jardiniers
accomplissent la plus digne des performances humaines : produire la
nourriture. Ils tiennent entre leurs mains à la fois la vie et le temps qu’ils
reconduisent ainsi de saison en saison. C’est pourquoi toute manipulation sur
les semences, toute entreprise de captation d’une espèce par le brevetage
– la stérilisation des espèces en première génération ou l’obtention de
variétés stériles conduisant à une obligation de rachat – ne s’apparente
pas à un crime, c’est un crime.
Le jardinier de demain n’est pas un justicier, ce n’est pas
à lui de rétablir les règles de l’équité, mais il peut compter sur les lois du
génie naturel, les comprendre et les favoriser. Il peut redistribuer les
graines de sa propre production dans un rapport de gratuité où il est question
à la fois d’échanger le temps et la puissance inventive du génie naturel. Nous
ne savons pas exactement ce que donnera la graine. Nous savons qu’elle nous
surprendra. Le jardinier ne se heurte pas au temps, il l’accompagne.
J’achève ce parcours au jardin en insistant sur
l’objet-temps. Aucune autre civilisation que la nôtre ne l’a si violemment
malmené. Les névroses conjuguées de la performance et de la compétitivité
– faisant de l’autre un ennemi et non un voisin, encore moins un
ami – ont transformé le parcours en exploit, le voyage en déplacement et
l’évaluation de toute chose en gain de temps par la vitesse.
Que faisons-nous du temps ainsi gagné ? N’est-il pas
immédiatement réinvesti dans une course au temps ? Celui qui, par hasard,
ne répond pas aux injonctions du système se voit culpabilisé, c’est un
paresseux, un oisif, il n’a rien à faire dans la société de la rentabilité du
temps, il sera pénalisé.
Au jardin, le système du temps gagné ou perdu s’effondre de
lui-même, il n’a simplement aucune raison d’être. La thérapie naturelle du
jardinage vient du temps suspendu, celui que l’on ne maîtrise pas mais qui,
d’une certaine façon, nous tient debout. Lorsqu’on met une graine en terre,
c’est un devenir qui s’annonce, le passé s’efface, la nostalgie au jardin n’a
pas cours. Le jardin est un lieu privilégié du futur, un territoire mental d’espérance.
·
10 « Le secret du
rêve », document fourni par Adrienne Cazeilles, mémoire des Aspres et du
Roussillon,(...)
Nous pourrions nous arrêter sur ces mots, ils ouvrent une
porte sur un futur heureux. Mais avant de conclure je propose un détour. En
cessant d’exercer notre regard à partir de l’Occident, nous allons à la
rencontre d’autres « mondes », d’autres pensées, d’autres
imaginaires, d’autres créations, d’autres cosmologies. Le jardin planétaire
nous en assure : la façon dont on imagine le monde a une répercussion
immédiate sur la façon dont on s’en occupe. Pour certaines civilisations, le mot jardin ne signifie rien. Je
m’étais étonné de l’absence de jardin dans les territoires aborigènes
d’Australie et mes questions sur ce sujet restaient sans réponses ;
jusqu’au jour où l’on porta à ma connaissance le message fondateur de cette
civilisation sous la forme d’un long poème dédié à la création10. L’Esprit en rêvant
s’adresse aux êtres de vie et s’assure de leur capacité au rêve mais, en dépit
de cette capacité, aucun ne maîtrise le « secret du rêve ». À
l’exception de l’homme, dernier être consulté dans la liste illustrant le
vivant. Après ce long travail, l’Esprit fatigué s’est couché dans la terre où
désormais il repose. Qui oserait le déranger, retourner le sol, blesser la
Terre ? Que signifie un jardin dans ces conditions ?
Référence au film de Werner Herzog Le pays où rêvent les fourmis vertes (1984) qui montre
comment une tribu aborigène affronte les bulldozers venus ouvrir une carrière
dans un pays où « rêvent les fourmis vertes », comment ils se
heurtent à cette violence jusqu’à en mourir.
Le mythe aborigène australien (fig. 10) s’accorde à une
histoire humaine où le nomadisme transformait le territoire en pourvoyeur du
bien commun : un jardin
sans jardinier. Tout le contraire de ce que nous venons de dire.
Cette heure passée en « leçon » pourrait se doubler d’une
« contre-leçon » où le jardin et le paysage tels que nos
civilisations les ont imaginés et développés seraient mis en péril par une
haute vision du génie naturel, un
autre monde en effet. Il
se pourrait que cela nous aide à inventer un modèle nouveau, adapté à la
finitude de l’espace et à la fragilité de la vie sur cette planète. Pour cela,
nous aurions besoin d’un peu de temps. Non ce temps de l’urgence et de la
compétition, mais celui de la création, permanent territoire de la subversion,
tout entier contenu dans l’art.
Une situation d’immersion ; regarder à hauteur d’herbe.
Copyleft Gilles Clément, licence Art libre 1.3.
Alors, j’invite les oisifs, les prétendus inutiles, les
lents, les accidentés de la vitesse à venir construire le projet de demain.
Nous avons besoin de leur résistance à l’immédiate réponse, de leur capacité à
s’étonner, à prendre le temps et à le laisser suivre son cours. Ensemble, nous
pourrons nous attarder à la simplicité d’une fleur (fig. 11), son éclat
dans la lumière, cette annonce d’un fruit, une aventure promise, une graine,
une invention forcément. Nous pourrons en faire le dessin et peut-être lui
donner un paysage. Nous pourrons même lui donner un nom.
Alors elle existera.
ANNEXES
La vidéo de la leçon inaugurale est disponible sur le site
du Collège de France :http://www.college-de-france.fr/site/gilles-clement/inaugural-lecture-2011-12-01-18h00.htm
NOTES
1 La phusis.
« Nature » mais surtout base de la réflexion philosophique des Grecs
d’Asie mineure. La phusis s’oppose au nomos, la
loi. Le terme s’applique aussi au processus de croissance, à l’évolution.
2 Par les accords de Nagoya, conclus en
octobre 2010 au Japon, plus de 190 pays, à l’exception des
États-Unis, adoptent pour 2020 un plan stratégique visant à freiner l’érosion
de la diversité sur la planète. Le point critique porte sur le protocole (en
négociation depuis les huit années précédant les accords) organisant le partage
des bénéfices tirés par les industries de la pharmacie et de la cosmétique à
partir des ressources génétiques des « pays du Sud ».
3 Le mot jardin vient du
germanique garten qui signifie « enclos ».Le motparadis,
du latin paradisus, du grec paradeisos, lui-même du
persan pairidaeza, « enclos », de pairi,
« autour » (qui donnera peri en grec) et daeza,
« rampant ».
4 Le concept d’écologie, proposé par le
biologiste libre-penseur allemand Ernst Haeckel, apparaît officiellement en
1866.
5 Claude Lorius et Laurent Carpentier, Voyage
dans l’Anthropocène, Actes Sud, 2011.
6 « Économiser signifie prendre
soin » (Bernard Stiegler, Ce qui vaut la peine d’être vécu. De la
pharmacologie, Flammarion, 2010, chap. 5).
7 Henri Laborit, La Nouvelle
Grille, Gallimard, coll. « Folio essais », 1985.
8 Yves Delange, Plaidoyer pour
les sciences naturelles : dès l’enfance, faire aimer la nature et la vie,
L’Harmattan, 2009.
9 L’une des exceptions intéressantes, en
matière de centres de formation appliquée à la nature et au paysage, est la
récente initiative de la communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, qui
a inauguré le 15 avril 2011 une structure pédagogique initialement
intitulée « École de la reconnaissance de la diversité en ville »,
devenue « École du jardin planétaire » à l’initiative de la ville de
Viry-Châtillon.
10 « Le secret du rêve »,
document fourni par Adrienne Cazeilles, mémoire des Aspres et du Roussillon,
auteure de Quand on avait tant de racines (2003) etVoyage
autour de mon jardin (2011) aux éditions Trabucaire.
LIST OF ILLUSTRATIONS
Title
|
Figure 1. La
troisième vision d’Hildegarde de Bingen : l’homme au sein de l’Univers (Scivias,
xiie siècle).
|
||
Caption
|
L’ensemble du cosmos semble se
déterminer en rapport avec l’homme.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 2.1M
|
||
Title
|
Figure 2. La
planète Terre vue depuis la station Mir.
|
||
Caption
|
Une perception éloignée de la biosphère,
espace vital limité à une fine pellicule représentée ici par la couche
nuageuse.
|
||
Credits
|
Photographie : Jean-Pierre
Haigneré.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 728k
|
||
Title
|
Figure 3
|
||
Caption
|
Le schéma des échanges proches et
lointains montrés sur ce dessin correspond à une interprétation des échanges
économiques souhaitables pour une société nouvelle. Il fait partie d’une
série de dessins exposés à la Biennale d’art contemporain de Melle en 2009
sur le thème de « l’homme symbiotique ». Ce même schéma est applicable
aux échanges d’énergie entre les biotopes naturels. Chaque biotope est
destiné à évoluer sous la pression des influences naturelles externes comme
chaque société humaine sous la pression des influences culturelles externes.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/png, 701k
|
||
Title
|
Figure 4.
L’évolution des sociétés envisagée comme une expansion progressive des
habitats au détriment de l’espace libre.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 336k
|
||
Title
|
Figure 5.
L’évolution des sociétés envisagée comme une réécriture des principes de vie
au sein d’un même espace (recyclage).
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 352k
|
||
Title
|
Figure 6.
« Fissure de timidité ».
|
||
Caption
|
La lumière résulte d’une mise à
distance des frondaisons d’arbres adultes appartenant à la même espèce
(ici, Samanea saman en Australie, au nord de Cairns).Cette
mise à distance correspond à des échanges entre les houppiers. On ignore la
nature et les raisons de ces échanges.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 1.3M
|
||
Title
|
Figure 7
|
||
Caption
|
La part de l’intervention de l’artiste
(traits et points soutenus) permettant une scénographie particulière de
l’espace envisagé ne signifie pas un abandon de ses prérogatives sur le
milieu vivant (petits points) mais une limitation de son action formelle à ce
qui rend lisible son message.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 460k
|
||
Title
|
Figure 8. Le chemin
comme principe scénographique de « limite ».
|
||
Caption
|
Jardin de l’École normale supérieure
de Lyon, site Descartes (Lettres et sciences humaines).
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 668k
|
||
Title
|
Figure 9. L’arbre,
symbole du recyclage permanent.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/png, 971k
|
||
Title
|
Figure 10. Fourmis
vertes (Cairns, Queensland, Australie).
|
||
Caption
|
Référence au film de Werner
Herzog Le pays où rêvent les fourmis vertes (1984) qui
montre comment une tribu aborigène affronte les bulldozers venus ouvrir une
carrière dans un pays où « rêvent les fourmis vertes », comment ils
se heurtent à cette violence jusqu’à en mourir.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 260k
|
||
Title
|
Figure 11. Le gazé
(Aporia crataegi) sur une scabieuse (Scabiosasuccisa).
|
||
Caption
|
Une situation d’immersion ;
regarder à hauteur d’herbe.
|
||
Credits
|
Copyleft Gilles Clément, licence Art
libre 1.3.
|
||
URL
|
|||
File
|
image/jpeg, 682k
|
AUTHOR
Gilles Clément
Professeur invité sur la chaire annuelle de Création artistique
pour l’année académique 2011-2012
© Collège de France, 2012
Terms of use: http://www.openedition.org/6540






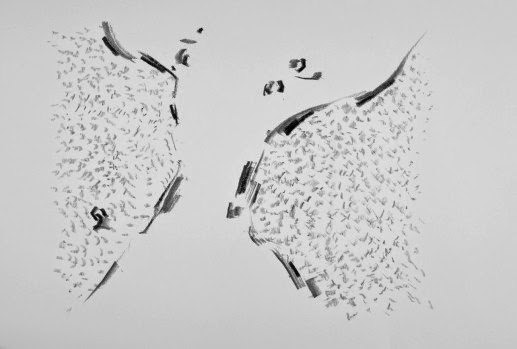




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.